Je suis tombée sur cet ouvrage à cause (ou grâce) à son sous-titre – à savoir : Essai de démonologie.
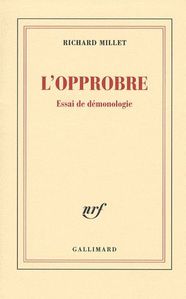 Il ne s’agit pas ici de démonologie classique, telle qu’elle s’est constituée à la fin du moyen-âge, ni telle qu’elle s’est déchainée à le Renaissance sous l’impulsion inquisitrice (cette débandade de bûchers, de chasseurs de démons, de procès en sorcellerie ou autres hérésies). Non, il s’agit là d’un essai de démonologie contemporaine. Les démons y sont tout autre… Autant dire qu’il s’agit d’une démonologie subjective, intimiste, narcissique, à l’image de nos cultes et idolâtries modernes, ou postmodernes.
Il ne s’agit pas ici de démonologie classique, telle qu’elle s’est constituée à la fin du moyen-âge, ni telle qu’elle s’est déchainée à le Renaissance sous l’impulsion inquisitrice (cette débandade de bûchers, de chasseurs de démons, de procès en sorcellerie ou autres hérésies). Non, il s’agit là d’un essai de démonologie contemporaine. Les démons y sont tout autre… Autant dire qu’il s’agit d’une démonologie subjective, intimiste, narcissique, à l’image de nos cultes et idolâtries modernes, ou postmodernes.
Le dieu de Richard Millet ? – Une certaine idée de la langue, de la forme en soi, du goût, de la littérature, et de leur dimension « sacrée ». Les démons de Richard Millet ? – L’évanescence, le relativisme, l’hybridation, l’informe… Le genre de son livre ? – Un recueil, disons. Recueil de maximes et de réflexions retranscrites sur un ton qui rappelle celles de Nietzsche. Certes, on a surtout décrit l’œuvre comme une réaction amère, plaintive et injurieuse face aux critiques qu’il avait reçu pour l’ouvrage précédent (quelque chose comme « La décadence de la littérature », il me semble). Et lui-même se montra alors dans les médias comme un pauvre petit homme, blanc, hétérosexuel, auteur incompris, publié chez Gallimard… Et d’ajouter qu’il n’avait rien pour lui, perdu qu’il était dans le tournoiement et les cris des minorités revendicatrices, muticulturalistes, bisexuelles, cosmopolites, obsolescentes – face auxquelles il ne reste guère que la réclusion au désert… On a souligné certains commentaires de Millet sur la laideur de la démocratisation des peuples, l'envahissement islamique (qu'il juge vide et purement réactionnaire face à l'hégémonie mondialisante), son regard indifférent sur une Afrique disgracieuse (excepté l'Ethiopie pour sa chrétienté), une nostalgie des origines, une obstination à discerner des races, des peuples et des cultures… On en a conclu à un livre raciste, décadent, réactionnaire et vain. Mais malgré l’ambigüité de cet ouvrage (dont le champ sémantique est tout rempli d’ennemis, de démons, de malins, d’adversaires et de diablotins déguisés en moralistes de l’ouverture et de l’altérité), Richard Millet ne cesse d’interpeller cette altérité et de dénoncer sa dislocation dans les processus qui la magnifient. Car ce n’est pas à l’autre, ni à l’étranger qu’il s’en prend, mais bien à l’informe, à celui qui empêche cet autre d’advenir, parce que tout est déjà malaxé et dissout en tout, et que la multitude apparente renvoie toujours à la même mixture aliénante, indéfiniment resservie dans différentes gamelles. Or Millet s’obstine à prendre un ton et des postures qui flirtent dangereusement avec les seuls tabous de notre époque (rejet de l’hégémonie mondialiste, mouvante et multiforme), de sorte qu’à force de voir le diable partout, c’est lui-même qui finit diabolisé. Le plus étonnant, c’est que cela ne l’étonne pas, et qu’il entre allègrement dans le rôle qu’on lui donne, quitte à perdre de vue la réalité du sujet abordé.
Si le sujet ne peut être abordé par un homme, blanc, mûr, hétérosexuel, auteur chez une maison prestigieuse, sans que l’opprobre ne lui tombe dessus, peut-être la chose sera-t-elle plus aisée à une femme, jeune, métisse, publiée par un escroc dépourvue de ligne éditoriale qui ne vise que le plus grand nombre… En effet, cet obscur livre (illustré ci-dessous) : La machine démonologique, aborde le même sujet. Sous un autre angle, cependant...
 L’ouvrage s’ouvre sur une histoire de la démonologie, ou plus précisément, une histoire du démon à travers les âges et les religions. Et comme le démon (sauf quand il n'est qu'illusion) n’est qu’un ange inversé, un symbole étranger, une divinité moribonde (dieux déchus, anciens, lointains, voire même, à venir), il n'est jamais dénué de confusion… Après avoir croisé, l’ange de Jacob, le Satan de Job, le tentateur du désert, la Lilith, l’Empousa, Prométhée (ou autres démiurges prométhéens), le Mara bouddhiste, les dévas, les asuras, l’Iblis de l’Islam, les serpents maléfiques et les serpents sacrés de moult et moult peuples, nous finissons par revenir à notre démonologie moderne (après un petit détour par les idéologies du XXème siècle, et quelques portraits fleuris d’Hitler, Staline ou Mussolini). Il arrive donc un moment où le démon cesse d’avoir une figure. Il n’est plus que mouvement, fulgurance, nébuleuse, absolue virtualité… Et dès lors : gare à celui qui osera critiquer cette nébuleuse, car elle n’en garantit pas moins une certaine liberté d’échange et d’expression. C’est vrai. Mais il semble qu’elle interdise du même coup toute structuration en profondeur…La machine démonologique étant le livre d’une inconnue sans lustre ni prestige, l’accent y est mis sur la documentation. L’auteur ne dit jamais rien sans révéler ses sources, extraire, citer, noter et référer. Au bout du compte, on découvre que bien d’autres auteurs de divers horizons (sociologues, théologiens, économistes, philosophes, psychologues, essayistes, romanciers) se sont attaqués au sujet, cherchant à débusquer, ce démon, cet informe ou cet autre, mais que jamais ils ne lui donnèrent le même nom. C’est pourquoi, il convient mieux d’examiner la machine en elle-même, plutôt que les représentations qu’elle produit d’âge en âge…Même combat que monsieur Richard Millet ? Non, ou bien… Un autre angle d’attaque, assurément. Infiniment autre.
L’ouvrage s’ouvre sur une histoire de la démonologie, ou plus précisément, une histoire du démon à travers les âges et les religions. Et comme le démon (sauf quand il n'est qu'illusion) n’est qu’un ange inversé, un symbole étranger, une divinité moribonde (dieux déchus, anciens, lointains, voire même, à venir), il n'est jamais dénué de confusion… Après avoir croisé, l’ange de Jacob, le Satan de Job, le tentateur du désert, la Lilith, l’Empousa, Prométhée (ou autres démiurges prométhéens), le Mara bouddhiste, les dévas, les asuras, l’Iblis de l’Islam, les serpents maléfiques et les serpents sacrés de moult et moult peuples, nous finissons par revenir à notre démonologie moderne (après un petit détour par les idéologies du XXème siècle, et quelques portraits fleuris d’Hitler, Staline ou Mussolini). Il arrive donc un moment où le démon cesse d’avoir une figure. Il n’est plus que mouvement, fulgurance, nébuleuse, absolue virtualité… Et dès lors : gare à celui qui osera critiquer cette nébuleuse, car elle n’en garantit pas moins une certaine liberté d’échange et d’expression. C’est vrai. Mais il semble qu’elle interdise du même coup toute structuration en profondeur…La machine démonologique étant le livre d’une inconnue sans lustre ni prestige, l’accent y est mis sur la documentation. L’auteur ne dit jamais rien sans révéler ses sources, extraire, citer, noter et référer. Au bout du compte, on découvre que bien d’autres auteurs de divers horizons (sociologues, théologiens, économistes, philosophes, psychologues, essayistes, romanciers) se sont attaqués au sujet, cherchant à débusquer, ce démon, cet informe ou cet autre, mais que jamais ils ne lui donnèrent le même nom. C’est pourquoi, il convient mieux d’examiner la machine en elle-même, plutôt que les représentations qu’elle produit d’âge en âge…Même combat que monsieur Richard Millet ? Non, ou bien… Un autre angle d’attaque, assurément. Infiniment autre.



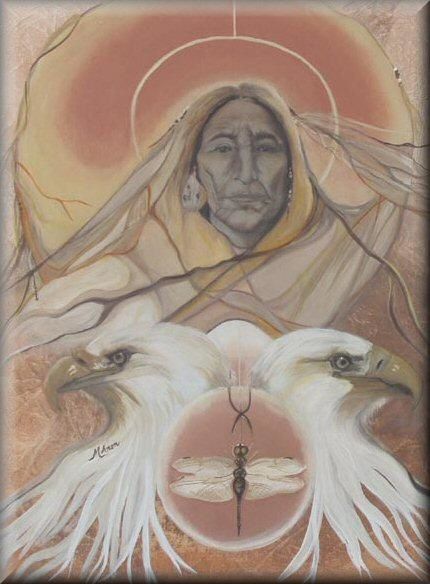





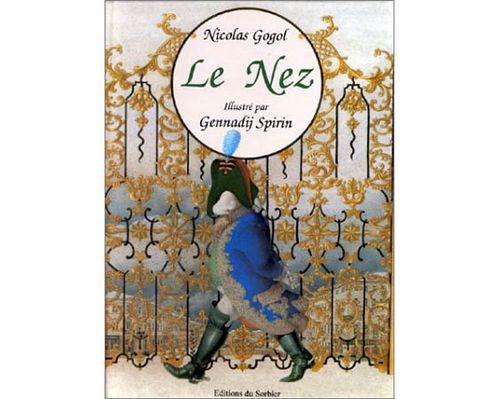


 L'autre jour, je me suis rendue à la fnac, spécialement pour jeter un oeil à ce nouveau livre iconoclaste : Le crépuscule d'une idole. Je n'ai jamais été fan de Freud (je préfère l'approche de Jung, peu apprécié en France), mais au final, je suis rentrée chez moi avec le petit traité d'athéologie d'Onfray...
L'autre jour, je me suis rendue à la fnac, spécialement pour jeter un oeil à ce nouveau livre iconoclaste : Le crépuscule d'une idole. Je n'ai jamais été fan de Freud (je préfère l'approche de Jung, peu apprécié en France), mais au final, je suis rentrée chez moi avec le petit traité d'athéologie d'Onfray... pauvre et laide, sous l'oeil inquiet de ses parents et amis qui ne comprendraient pas ce qu'il lui trouve... Impulsion irrationnelle, donc, mais propre à l'histoire humaine, laquelle se manifeste ainsi dans bien d'autres configurations, et dont on ne saurait se défaire sans renoncer à soi-même. Cette "autre chose" ne se discute pas, sauf si l'individu en question en vient à construire toute une théorie pour justifier son inclination et l'ériger en nouvelle norme. L'exception devenue règle ! Le génie du singulier dont la volonté s'impose à tous collectivement. L'idéologie comme remède à la négation d'une particularité (mais bientôt comme nouvelle source de négation)... Religion, science, politique, art : les représentations et les explications du monde changent au gré des hommes d'élite, mais elles ne changent que lorqu'une autre vision a acquis suffisamment d'ampleur pour remplacer la précédente.
pauvre et laide, sous l'oeil inquiet de ses parents et amis qui ne comprendraient pas ce qu'il lui trouve... Impulsion irrationnelle, donc, mais propre à l'histoire humaine, laquelle se manifeste ainsi dans bien d'autres configurations, et dont on ne saurait se défaire sans renoncer à soi-même. Cette "autre chose" ne se discute pas, sauf si l'individu en question en vient à construire toute une théorie pour justifier son inclination et l'ériger en nouvelle norme. L'exception devenue règle ! Le génie du singulier dont la volonté s'impose à tous collectivement. L'idéologie comme remède à la négation d'une particularité (mais bientôt comme nouvelle source de négation)... Religion, science, politique, art : les représentations et les explications du monde changent au gré des hommes d'élite, mais elles ne changent que lorqu'une autre vision a acquis suffisamment d'ampleur pour remplacer la précédente.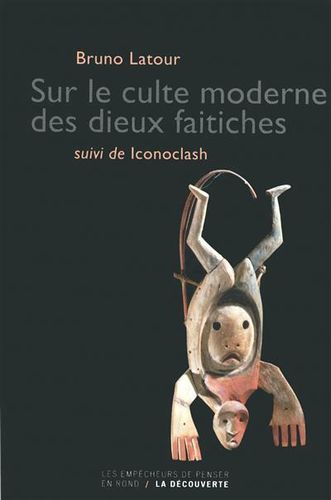 Ce petit livre du sociologue et philosophe des sciences, Bruno Latour, se propose de dégager un passage à travers les deux pôles opposés d’une éternelle illusion : la critique de la croyance et la croyance en la critique.
Ce petit livre du sociologue et philosophe des sciences, Bruno Latour, se propose de dégager un passage à travers les deux pôles opposés d’une éternelle illusion : la critique de la croyance et la croyance en la critique.


 Je voudrais aujourd'hui évoquer le livre "Le déclin de l'Occident" d'Oswald Spengler, paru entre les deux dernières guerres mondiales. Cet auteur qui fut approché par le pouvoir nazi (et qui s'en écarta) jeta pourtant un regard complaisant sur la dictature italienne dans laquelle il crut voir l'avènement du césarisme annoncé dans son texte.
Je voudrais aujourd'hui évoquer le livre "Le déclin de l'Occident" d'Oswald Spengler, paru entre les deux dernières guerres mondiales. Cet auteur qui fut approché par le pouvoir nazi (et qui s'en écarta) jeta pourtant un regard complaisant sur la dictature italienne dans laquelle il crut voir l'avènement du césarisme annoncé dans son texte.
 Voici quelques réflexions et extraits issus du livre L'Antéchrist, par Frédéric Nietzsche.
Voici quelques réflexions et extraits issus du livre L'Antéchrist, par Frédéric Nietzsche.