
Le thème du mystère primordial, de l'oubli, de l'absence, tout comme la quête du sens en général, seraient plutôt d'ordre métaphysique, mythologique ou théologique... C'est du moins ce qui semble a priori. L'homme s'absorbe dans des chimères et se questionne sur l'au-delà par crainte de la mort ou par goût de l'illusion : ceci explique cela... Mais il semblerait que ce soit également un enjeu de taille (des centaines de millions de dollars déboursés sur la question !) dans les domaines de la physique et de l'économie. Dans quel but ? -- débusquer et exploiter l'antimatière ! Il faut dire que sa maîtrise réglerait définitivement nos problèmes énergétiques (sauf que l'antimatière semble avoir disparu de l'univers)... Je ne sais plus par quel chemin j'en suis venue à m'interroger sur les antiparticules (et je suis déjà épuisée rien qu'à l'idée de me replonger dans ce cheminement mental), mais voilà le genre d'articles qui m'attirent comme un aimant depuis une demi douzaine de jours... De quoi alimenter ce blog, si sublimement déserté par l'auteur de ces lignes...
Les articles qui suivent ont été récoltés sur le site du CNRS.
Dans la soupe primordiale, les particules et leurs antiparticules se créent puis s’annihilent sans arrêt à partir de pure énergie. En quelque sorte, les unes sont un peu l’image des autres dans un miroir. Matière et antimatière étaient toutes deux présentes en quantités égales au départ. Seulement, pour une raison inconnue, la première a pris le pas sur la seconde… Celle-ci a presque disparu en raison d’une subtile différence de comportement. Comment et pourquoi ? C’est là tout un mystère à l’origine de notre existence même
Qu’est-ce que l’antimatière ?
Petite histoire d’un curieux double du monde ordinaire
L’histoire de l’antimatière a commencé en 1928, sous l’impulsion du jeune Britannique Paul Dirac (1902-1984). Jusqu’alors, pour expliquer les substances que nous, voyons, goûtons et touchons, il n’y avait besoin que d’atomes. Ceux-ci sont constitués d’électrons, protons et neutrons. Cependant, Dirac se penche sur l’équation qui régit le destin de la matière… et qui lui vaudra le prix Nobel de physique en 1932. Surprise : Cette formule «magique» se comporte de façon "symétrique". Elle prédit tout autant l’existence de l’électron que celle de l’antiélectron - le positron, doté d’une masse identique et d’une charge électrique opposée. De même, les protons sont associés à des antiprotons. Cette vision prévoit un double du monde usuel. Une copie qui lui ressemble trait pour trait. La seule différence est que l’antimonde se révèle comme le reflet dans un miroir de la population des particules ordinaires. Dans l’enthousiasme du début XXe siècle ceci découle directement de la théorie de la relativité d’Einstein et de la mécanique quantique.
La confirmation vient en 1932. Le Californien Carl Anderson repère la trace d’une particule porteuse de charge positive - l’antiélectron - dans les rayons cosmiques qui tombent du ciel et «arrosent» l’atmosphère. Cette découverte sera saluée par le Nobel 1936.
Aujourd’hui, toutes les particules élémentaires ont révélé leur «sosie». Elles s’en distinguent par les nombres quantiques dits de "charge" (électrique, baryonique, leptonique…). La masse, elle, reste inchangée. Le photon est sa propre antiparticule. Matière et antimatière ont le même nombre quantique de rotation (spin). Et la même durée de vie.
L’annihilation
Immédiatement, l’antimatière apparaît comme une source providentielle d’énergie. Elle constitue un exact opposé de la matière. À son contact, les deux se détruisent – « s’annihilent » - en libérant une puissance colossale. Ceci résulte de la fameuse équation d’équivalence masse-énergie (E=mc2) posée par Albert Einstein en 1905. D’une manière triviale, l’énergie correspond à l’argent que dépense mère nature. Il circule sous deux monnaies entre lesquelles s’applique un taux de change élevé (carré de la vitesse de la lumière). Et l’annihilation assure une conversion très efficace. Voilà pourquoi, sur le papier, la combustion d’un kilogramme de sucre peut propulser une voiture pendant 100 000 ans. Ou générer 25 milliards de kilowattheures et alimenter une ville pendant trois ans…
L’antimatière au quotidien
Avec des propriétés aussi fabuleuses, l’antimatière n’a pas tardé à stimuler les imaginations les plus folles. Et la science-fiction. Dans Star Trek, série télévisée créée en 1966 par Gene Roddenberry, le vaisseau Enterprise se propulse à des vitesses supérieures à celles de la lumière par déformation de l’espace,… puis en consommant de l’antimatière… Bien évidemment, en dépit d’essais opiniâtres, on reste loin de réaliser de tels exploits. Aux États-Unis, dans les années 80, le programme de Guerre des étoiles a étudié la possibilité d’utiliser l’antimatière comme carburant de fusées, ou pour actionner des plateformes d’armes. Heureusement, il a échoué. Mais d’autre part, des expériences plus pacifiques sont régulièrement conduites au Cern de Genève. Elles aboutissent à produire, en un an, assez d’antiprotons pour… allumer une ampoule de 100 watts pendant trois secondes. Le rendement avoisine 0,000 000 01 %. Pas de quoi pavoiser. La machine à vapeur du XIXe siècle s’avère des millions de fois plus efficace en termes de labeur.
Pour nous consoler, il reste l’application quotidienne de la Tomographie par émission de positrons (TEP). Cette technique d’imagerie médicale "photographie" le cerveau en train de penser. Un fluide radioactif est introduit dans le corps du patient. Les positrons s’annihilent avec les électrons environnants. Le résultat est une émission d’énergie gamma. Oublions, par contre, les "cerveaux positroniques", bien plus sophistiqués que ceux des humains, qui faisaient fantasmer Isaac Asimov avec le cycle des Robots dans les années 40. Réjouissons-nous, en revanche, de constater que, sans arrêt au-dessus de nos têtes, les rayons cosmiques et les explosions de supernovae créent des antiélectrons à profusion.
Antimatière, où es-tu ?
Reste un brûlant paradoxe. Comment la jolie équation de Dirac, si harmonieuse, a-t-elle abouti à un Univers aussi bancal ? Comment la matière a-t-elle pris le pas sur sa consœur-ennemie ? A l’échelle cosmique, plus une once d’antimatière ne subsiste. Sauf de rares monstruosités, telles que le voisinage du trou noir au cœur de notre galaxie, l’antimatière reste désespérément absente. C’est heureux. Mais c’est aussi un drame pour la théorie : à l’aube des temps matière et antimatière devraient être présentes en poids égal. Elles se créaient et s’autodétruisaient sans cesse dans un bouillonnement effervescent.
Où est passée l’antimatière primordiale ? "Antimatière, où es-tu ?", entend-on s’écrier avec effroi. La réponse tient à une subtile et infime différence de comportement entre les deux faces de la même pièce. Les sœurs opposées ne seraient pas si jumelles. Plusieurs expériences ont indiqué que, dans certains cas, l’antimatière se démarque de sa double. Finie, la pâle copie. Le miroir se fêle. Et ces "violations de symétries" fascinent. Car elles sont un avant-goût de découvertes à venir. Certes a priori le big bang n’aurait pu produire les deux espèces qu’avec une grande équité. Mais ensuite, à mesure que le cosmos s’est étendu et refroidi, son contenu a réagi pour s’adapter. L’anomalie de la matière s’est manifestée. Sa consoeur a été engloutie. Elle a disparu. Et ceci n’a laissé que des quarks sans antiquarks. Des électrons sans antiélectrons. Notre corps, même, représente ce reliquat de l’immensité primordiale. L’essentiel s’est envolé. On estime que la dissonance, fausse note initiale, qui affectait la matière ne dépasse pas une partie pour un milliard. 0,000 000 001. C’est le mince surcroît de force dont elle a bénéficié pour… anéantir sa sœur.
Ainsi s’expliquerait cette hégémonie écrasante dans l’Univers. D’ailleurs, si l’antimatière avait survécu, elle nous annihilerait tous dans un flash. Et nous ne nous appesantirions pas sur le sujet. C’est Andreï Sakharov, père de la bombe à hydrogène soviétique, et Nobel de la paix, qui le premier a donné une interprétation cosmologique de cette drôle d’inclination, ou penchant, de la nature. Précisons que les expériences de distinction entre matière et antimatière n’ont mis en œuvre jusqu’ici que l’interaction nucléaire faible. Or l’ordre de grandeur du résultat est tout à fait insuffisant si l’on veut rendre compte du schisme réel. La vraie dissymétrie, dont nous sommes issus, remonterait en fait jusqu’à l’ère de grande unification des forces d’interaction (nucléaires forte, faible et électromagnétique). Autrement dit, des énergies beaucoup plus élevées et… hors d’atteinte.
Une entêtante énigme
Aux origines de notre existence
En 1966, Andreï Sakharov a pris en considération un tel univers unifié, régi par une seule force à côté de la gravité. Il en a déduit les trois conditions pour que la matière vienne à prédominer. D’abord, elle doit être très légèrement instable. Le phénomène est lent. Mais sur Terre, la valeur d’une miette de pain devrait s’être volatilisée depuis que notre planète existe. Des expériences souterraines, telles que le tunnel de Modane au Mont Fréjus, dans les Alpes françaises, ont longtemps traqué une désintégration spontanée du proton sur 1031 ans. Mais, il faut bien l’avouer : en vain. La seconde condition posée par Sakharov paraît une évidence : l’Univers, dans sa prime jeunesse, se trouvait loin de l’équilibre… Euphémisme, vu la violence de son expansion ! Enfin, la troisième condition n’est autre q’une subtile différence attendue à l’échelle microscopique entre matière et antimatière.
La confirmation est venue de James Cronin et Val Fitch, au laboratoire de Brookhaven, à New York, en 1964. La démarche, qui a mené au Nobel 1980, était d’étudier la désintégration d’un méson neutre K ou kaon (composé d’un quark « bas » et d’un antiquark «étrange») à durée de vie longue. Ceci met en jeu un phénomène exotique de mélange entre quarks et antiquarks. Le kaon « oscille » entre kaon et antikaon. En outre, il se désintègre de préférence en positron plutôt qu’en électron… Ceci implique deux brisures de symétries fondamentales : l’image dans un miroir, ou inversion droite-gauche, et l’échange de la particule avec son antiparticule. Ces opérations sont appelées parité (P) et conjugaison de charge (C). Il existe une troisième symétrie intéressante, l’inversion du temps (T). Or, les lois de la nature sont toujours invariantes quand on effectue la transformation combinée charge-parité-temps (CPT). Longtemps, on a même cru que l’Univers respectait chacune d’elle. Il n’en est rien. Cronin, Fitch et leur collègue français René Turlay ont montré que certains processus violent la symétrie charge-parité (CP).
Si bien que les contours du scénario de disparition de l’antimatière peuvent commencer à s’esquisser. À l’ère de grande unification, 10-35 seconde après le big bang, il règne une température de 1027 degrés et l’énergie ambiante avoisine 1016 milliards d’électronvolts. Les interactions nucléaires et électromagnétiques se confondent à côté de la gravité. À ce stade, les quarks sont indiscernables des positrons. Et les antiquarks des électrons. Les uns se transforment allègrement en les autres. De même que les neutrinos « fantômes » oscillent en trois «saveurs» distinctes. La dissymétrie matière-antimatière est alors invisible. Puis le temps fait son office. Dans cette chronologie, il apparaît des réactions irréversibles. Du coup, les positrons se transforment davantage en quarks que les électrons en antiquarks. Ainsi va la vie. Une dissymétrie inéluctable naît. Qui décide de l’avenir.
Selon les derniers progrès de la réflexion en cours : ce pourrait être les neutrinos eux-mêmes – anges de la matière insaisissables dotés d’une très faible masse – qui incarnent les vrais responsables du déséquilibre fatal à l’antimatière. Ces corpuscules, difficiles à atteindre, évoluent dans un monde qui interagit faiblement avec notre quotidien. Et ils seraient, en définitive, à l’origine de notre existence !.. Des expériences d’une sensibilité et d’une dimension inégalées sont proposées pour confirmer ce point. Des «usines à neutrinos» et un détecteur d’un million de tonnes (projet mégatonne) pourraient être mise en oeuvre dans les 20 prochaines années en France (mont Fréjus), au Japon ou aux États-Unis.
L’antimatière est un double-miroir de la matière usuelle. Soit. Mais pourquoi a-t-elle disparu de notre horizon ? Et sommes-nous finalement si sûrs de ce constat ? Une question dérangeante: n’existerait-il pas, ailleurs, des "antimondes" peuplés d’antiétoiles et d’antiplanètes ? Le problème sera abordé - avec sérieux - en 2007* dans l’expérience AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) sur la station spatiale internationale. Un détecteur de sept tonnes tentera de déceler des… antinoyaux forgés au cœur d’antiétoiles !..
"L’antimatière est-elle une curiosité de physiciens qui la font apparaître tous les jours sur Terre ? Ou bien au contraire, est-elle très répandue dans de larges régions de l’Univers ?". Telle est la question, un brin provocatrice, que pose Aurélien Barrau chercheur-enseignant au Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie de Grenoble. Il est membre de l’expérience AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) qui sera embarquée en 2007 à bord de la station spatiale internationale. "De manière plus précise, les lois fondamentales de la nature semblent presque parfaitement équilibrées – on dit ‘symétriques’ - au niveau microscopique", reprend le spécialiste. "Les particules de matière, à de rares exceptions, se comportent de manière identique aux antiparticules. Dès lors, comment expliquer que l’Univers proche, observé avec les télescopes, apparaisse presque exclusivement constitué de matière ?". Bien sûr, ce fait est salutaire pour nous terriens. Il garantit que nous ne serons pas anéantis par une rencontre inopportune...! "Toutefois, il pose un problème de fond aux théoriciens pour expliquer cette asymétrie criante à grande échelle. Les observations éliminent de façon fiable l’existence d’antimatière primordiale dans l’amas local de galaxies où nous résidons. Le constat tient jusqu’à une distance d’environ 50 millions d’années-lumière."
Antinoyaux et antiétoiles
D’où la question : comment ce microcosme, respectueux de l’harmonie entre particules et antiparticules, a-t-il pu engendrer un tel macrocosme dominé par la matière ? Comment celle-ci a-t-elle pu prendre le dessus sur sa consoeur-ennemie ? Telle est l’entêtante énigme à la résolution de laquelle s’attèlent 200 chercheurs dont le prix Nobel de physique 1976 Samuel Ting. Un élément de réponse possible – et en général peu privilégié - serait que l’hégémonie écrasante de la matière n’est que pure illusion : nous habiterions une région particulière du cosmos, près du Soleil dans notre galaxie la Voie lactée. "On peut imaginer que l’Univers dans son ensemble se compose de domaines cloisonnés où règnent alternativement matière et antimatière", suggère Aurélien Barrau. "De fait, les galaxies les plus lointaines connues jusqu’ici, distantes de milliards d’années-lumière, ne nous communiquent leur pedigree qu’à travers leur rayonnement. Autrement dit, nous n’avons encore observé que leur lumière - rigoureusement indiscernable de l’antilumière qu’émettrait une antigalaxie. On ne peut exclure qu’il s’agisse d’antimondes éloignés qui abritent des antiétoiles et des antiplanètes. Sur certaines - pourquoi pas ? - des antiscientifiques s’anti-interrogeraient sur ce qu’ils anti-observent…"
Le modèle d’Univers qui prévaut ici s’appuie sur celui utilisé pour décrire le comportement des matériaux ferromagnétiques. Au refroidissement, une transition de phase – c’est-à-dire un changement d’état physique, comme lorsque l’eau liquide gèle et se transforme en glace – s’opère. Le matériau se subdivise en régions aimantées dans des sens opposés. Au total, la neutralité – donc l’équilibre entre matière et antimatière – se trouve conservé. "Par contre, la propagation des états choisis de manière aléatoire provoque des phénomènes complexes au niveau des parois entre domaines", prévient Aurélien Barrau. "Il faut s’attendre à des annihilations violentes aux frontières de la matière et de l’antimatière." Les mesures entre 1 et 100 millions d’électrons-volts d’énergie du télescope à rayons gamma Egret, à bord du satellite Compton, n’ont rien enregistré de tel.
Le plus gros détecteur de particules dans l’espace
Pour en avoir le cœur net, l’expérience AMS tentera de détecter des antinoyaux d’hélium ou de carbone hors de l’atmosphère terrestre. Là, l’interprétation deviendra incontestable. En effet, "l’identification d’un seul antinoyau de ce type et d’origine cosmique sera suffisante pour conclure à l’existence d’antimondes issus du big bang primordial. Des antinoyaux lourds ne peuvent provenir que des réactions nucléaires à l’œuvre au cœur d’antiétoiles."
Concrètement, le signal attendu – un flux d’antinoyaux qui nous parviendraient après avoir voyagé pendant des millions d’années dans l’espace – demeure extrêmement faible. L’expérience AMS a été dimensionnée en conséquence. D’un poids de sept tonnes pour une puissance électrique consommée de 2 000 watts, elle disposera d’une surface collectrice d’un mètre-carré et 300 000 canaux électroniques d’analyse. Ce sera de loin le "détecteur de particules le plus complet jamais emporté en orbite autour de la Terre". Arrimé aux flancs de la station spatiale internationale, ce cylindre de 3 mètres de diamètre sera contrôlé par les astronautes pendant trois ans jusqu’en 2011. On enregistrera les passages de particules énergétiques au rythme de 1000 coups par seconde (1 kilo-hertz). Là, un colossal aimant supra-conducteur refroidi à -271°C (2 K) par de l’hélium superfluide générera un champ magnétique d’une intensité d’un Tesla dans un volume d’un mètre-cube : de quoi distinguer avec certitude les noyaux des antinoyaux. Pour plus de sécurité, le spectromètre fonctionnera de plusieurs manières différentes et avec des éléments redondants. Ainsi la probabilité d’une fausse alerte à l’antimatière cosmologique sera réduite au minimum. Le coût de l’expérience est estimé à plusieurs centaines de millions de dollars. Le lancement dans l’espace sera assuré par la navette de la Nasa. La collaboration internationale associe 50 laboratoires liés à 17 pays.
Matière noire, trous noirs et étoiles étranges
Du côté des retombées scientifiques secondaires : de l’aveu des experts impliqués, "elles s’avèreront au moins aussi importantes que la quête de l’antimatière elle-même". En effet, vu la controverse sur l’existence de cette dernière dans l’Univers, il est apparu opportun d’optimiser l’exploitation de la mission. Et d’en tirer tout le miel possible. "Notre projet se distingue par son extraordinaire potentiel de découverte en physique au sens large", indique Aurélien Barrau. Au-delà de l’antimatière, l’aimant supraconducteur traquera aussi les antiprotons et les antiélectrons produits par l’annihilation spontanée de particules et d’antiparticules… de "matière noire". Il s’agit des fameuses Mauviettes, particules massives interagissant faiblement, ou Wimps (Weakly Interactive Massive Particles), alias les neutralinos d’une masse d’environ 100 milliards d’électrons-volts prévus par les nouvelles théories d’unification et de supersymétrie. Bonus : elles fournissent un excellent candidat afin d’expliquer la matière noire dont la masse constitue 35 à 40 % du contenu de l’Univers. Problème : la nature de cette dernière reste inconnue. Dans d’autres registres, AMS contribuera à élucider l’origine des rayons cosmiques. Un mystère qui perdure depuis un siècle. Le détecteur analysera les rayons gamma de haute énergie. Et cerise sur le gâteau : il pourrait déceler les effets exotiques de l’évaporation de mini-trous noirs. Ou bien de très étranges… "étoiles à quarks".

*NOTES :
Le spectromètre magnétique Alpha (en anglais Alpha Magnetic Spectrometer) ou AMS-02 est une expérience de physique des particules installée à bord de la Station spatiale internationale depuis 2011. Il rassemble autour d'un aimant de grande puissance un ensemble de détecteurs qui doivent permettre de caractériser les particules et antiparticules des rayons cosmiques. En accumulant les observations sur la durée, cette expérience pourrait apporter des éléments de réponse à des questions fondamentales soulevées ces dernières années par la physique, telles que la nature de la matière noire et l'abondance de l'antimatière dans notre Univers. Le recueil des données est planifié sur toute la durée de vie de la station spatiale mais les premiers résultats publiés en avril 2013 semblent confirmer les théories les plus courantes relatives à l'existence de la matière noire.



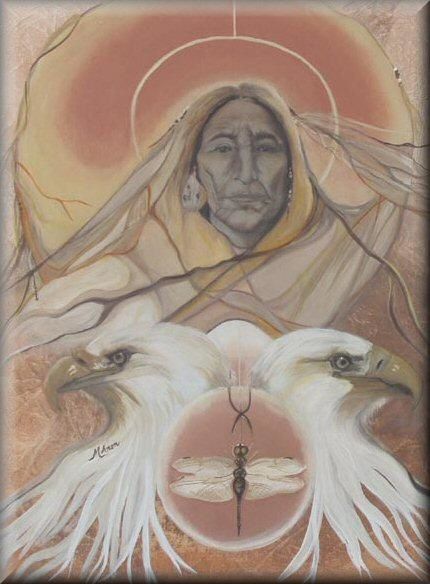







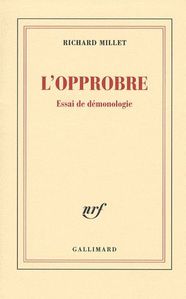 Il ne s’agit pas ici de démonologie classique, telle qu’elle s’est constituée à la fin du moyen-âge, ni telle qu’elle s’est déchainée à le Renaissance sous l’impulsion inquisitrice (cette débandade de bûchers, de chasseurs de démons, de procès en sorcellerie ou autres hérésies). Non, il s’agit là d’un essai de démonologie contemporaine. Les démons y sont tout autre… Autant dire qu’il s’agit d’une démonologie subjective, intimiste, narcissique, à l’image de nos cultes et idolâtries modernes, ou postmodernes.
Il ne s’agit pas ici de démonologie classique, telle qu’elle s’est constituée à la fin du moyen-âge, ni telle qu’elle s’est déchainée à le Renaissance sous l’impulsion inquisitrice (cette débandade de bûchers, de chasseurs de démons, de procès en sorcellerie ou autres hérésies). Non, il s’agit là d’un essai de démonologie contemporaine. Les démons y sont tout autre… Autant dire qu’il s’agit d’une démonologie subjective, intimiste, narcissique, à l’image de nos cultes et idolâtries modernes, ou postmodernes.  L’ouvrage s’ouvre sur une histoire de la démonologie, ou plus précisément, une histoire du démon à travers les âges et les religions. Et comme le démon (sauf quand il n'est qu'illusion) n’est qu’un ange inversé, un symbole étranger, une divinité moribonde (dieux déchus, anciens, lointains, voire même, à venir), il n'est jamais dénué de confusion… Après avoir croisé, l’ange de Jacob, le Satan de Job, le tentateur du désert, la Lilith, l’Empousa, Prométhée (ou autres démiurges prométhéens), le Mara bouddhiste, les dévas, les asuras, l’Iblis de l’Islam, les serpents maléfiques et les serpents sacrés de moult et moult peuples, nous finissons par revenir à notre démonologie moderne (après un petit détour par les idéologies du XXème siècle, et quelques portraits fleuris d’Hitler, Staline ou Mussolini). Il arrive donc un moment où le démon cesse d’avoir une figure. Il n’est plus que mouvement, fulgurance, nébuleuse, absolue virtualité… Et dès lors : gare à celui qui osera critiquer cette nébuleuse, car elle n’en garantit pas moins une certaine liberté d’échange et d’expression. C’est vrai. Mais il semble qu’elle interdise du même coup toute structuration en profondeur…
L’ouvrage s’ouvre sur une histoire de la démonologie, ou plus précisément, une histoire du démon à travers les âges et les religions. Et comme le démon (sauf quand il n'est qu'illusion) n’est qu’un ange inversé, un symbole étranger, une divinité moribonde (dieux déchus, anciens, lointains, voire même, à venir), il n'est jamais dénué de confusion… Après avoir croisé, l’ange de Jacob, le Satan de Job, le tentateur du désert, la Lilith, l’Empousa, Prométhée (ou autres démiurges prométhéens), le Mara bouddhiste, les dévas, les asuras, l’Iblis de l’Islam, les serpents maléfiques et les serpents sacrés de moult et moult peuples, nous finissons par revenir à notre démonologie moderne (après un petit détour par les idéologies du XXème siècle, et quelques portraits fleuris d’Hitler, Staline ou Mussolini). Il arrive donc un moment où le démon cesse d’avoir une figure. Il n’est plus que mouvement, fulgurance, nébuleuse, absolue virtualité… Et dès lors : gare à celui qui osera critiquer cette nébuleuse, car elle n’en garantit pas moins une certaine liberté d’échange et d’expression. C’est vrai. Mais il semble qu’elle interdise du même coup toute structuration en profondeur…


 Premières pages disponibles sur le site de l'éditeur, et en fichier PDF en ligne.
Premières pages disponibles sur le site de l'éditeur, et en fichier PDF en ligne. 


 décrire la façon dont une jeune culture se retrouve parfois prisonnière des formes cristallisées d’une vieille civilisation, mourante ou déjà morte. Dans un tel cas de figure, la jeune culture peine à déployer sa propre symbolique, son propre langage, son architecture, ses arts et ses techniques à un rythme personnel, obligée d’user d’un langage qui n’est pas le sien, traînant sa petite âme dans une dépouille étrangère… Spengler voit l’homme comme le fruit d’une culture, et la culture comme une plante enracinée dans un terreau. Toute tendance au détachement de sa propre nature, aux abstractions virtuelles, au cosmopolitisme, à l’utilitarisme massif, sont autant de symptômes d’une perte de vitalité à ses yeux, et d’un prochain déclin.
décrire la façon dont une jeune culture se retrouve parfois prisonnière des formes cristallisées d’une vieille civilisation, mourante ou déjà morte. Dans un tel cas de figure, la jeune culture peine à déployer sa propre symbolique, son propre langage, son architecture, ses arts et ses techniques à un rythme personnel, obligée d’user d’un langage qui n’est pas le sien, traînant sa petite âme dans une dépouille étrangère… Spengler voit l’homme comme le fruit d’une culture, et la culture comme une plante enracinée dans un terreau. Toute tendance au détachement de sa propre nature, aux abstractions virtuelles, au cosmopolitisme, à l’utilitarisme massif, sont autant de symptômes d’une perte de vitalité à ses yeux, et d’un prochain déclin. appelle à ne pas résister à l’occupant allemand, voyant dans l’effondrement de ce « monde décrépit » une occasion de délivrance et de rupture avec le conservatisme des ploutocrates et le babillage stérile des parlementaires… Cette occasion était-elle assez belle pour passer outre les thèses nazies ? La chose le discrédite… Conscient d’avoir un peu trop vite cédé à l’utopie, et bientôt étouffé par la pression des autorités allemandes, il s’exilera dès novembre 1941 en Haute Savoie, puis en Suisse, tout de suite après la guerre. Toujours est-il qu’un parfum de traitrise colle désormais à l’œuvre d’Henri de Man – personnage tout en contradictions. Homme ascétique et exigeant, attaché à de hautes valeurs culturelles, œuvrant dans le sens d’une révolution sociale, tout en demeurant étrangement fasciné par la figure de son roi Léopold III, peut-être trouva t’il momentanément dans l’idéologie allemande des aliments inavouables à son goût aristocratique ?
appelle à ne pas résister à l’occupant allemand, voyant dans l’effondrement de ce « monde décrépit » une occasion de délivrance et de rupture avec le conservatisme des ploutocrates et le babillage stérile des parlementaires… Cette occasion était-elle assez belle pour passer outre les thèses nazies ? La chose le discrédite… Conscient d’avoir un peu trop vite cédé à l’utopie, et bientôt étouffé par la pression des autorités allemandes, il s’exilera dès novembre 1941 en Haute Savoie, puis en Suisse, tout de suite après la guerre. Toujours est-il qu’un parfum de traitrise colle désormais à l’œuvre d’Henri de Man – personnage tout en contradictions. Homme ascétique et exigeant, attaché à de hautes valeurs culturelles, œuvrant dans le sens d’une révolution sociale, tout en demeurant étrangement fasciné par la figure de son roi Léopold III, peut-être trouva t’il momentanément dans l’idéologie allemande des aliments inavouables à son goût aristocratique ? Certes, tout ceci semble bien caricatural, et cette réalité éclatée serait insupportable sans une troisième sphère pacifiante, symbolique, palliative, laquelle joue entre ces deux mouvements un rôle de pseudo médiatrice. Il s’agit là d’une médiation simulée, impuissante à dépasser les oppositions par une combinaison nouvelle, mais ce doux simulacre n’en tient pas moins un rôle phare dans nos sociétés. Cette sphère artificielle, suspendue entre deux réalités inconfortables, déploie tout un éventail de représentations hypnotisantes, de discours soporifiques, de modèles sur mesure, éphémères ou jetables, de flux d’informations, de justifications, de communications, de mises en scène, etc... Cet étrange bricolage a tenu bon pendant un temps, feignant de combler l’écart entre ces deux réalités. Mais aujourd’hui, les fissures prennent d’inquiétantes proportions. Ce sont d’éternels discours auxquels personne ne croit, d’étranges réunions auxquelles personne ne vient, d’incompréhensibles rapports que nul ne lit, d’improbables programmes que personne n’assimile ; des spectacles tragiques, comiques, évanescents ; des icones comestibles, des jongleries budgétaires, des lois inapplicables ; des terrains dévastés, maquillés, pommadés ; des montagnes de déchets ensevelies sous du béton ; des mémoires supprimées, instrumentalisées, reformulées, commémorées ; des théories irréalistes que viennent suppléer des pratiques innommables à l’ombre d’une rhétorique policée, etc… Il suffit de faire un petit tour dans les hôpitaux, les écoles, les associations, les cabinets de « consultants », les galeries d’art, chaque recoin de la société, et de jeter un regard circulaire sur les contradictions bizarres ou malsaines qui s’y tapissent, en deçà des images et des discours officiels…
Certes, tout ceci semble bien caricatural, et cette réalité éclatée serait insupportable sans une troisième sphère pacifiante, symbolique, palliative, laquelle joue entre ces deux mouvements un rôle de pseudo médiatrice. Il s’agit là d’une médiation simulée, impuissante à dépasser les oppositions par une combinaison nouvelle, mais ce doux simulacre n’en tient pas moins un rôle phare dans nos sociétés. Cette sphère artificielle, suspendue entre deux réalités inconfortables, déploie tout un éventail de représentations hypnotisantes, de discours soporifiques, de modèles sur mesure, éphémères ou jetables, de flux d’informations, de justifications, de communications, de mises en scène, etc... Cet étrange bricolage a tenu bon pendant un temps, feignant de combler l’écart entre ces deux réalités. Mais aujourd’hui, les fissures prennent d’inquiétantes proportions. Ce sont d’éternels discours auxquels personne ne croit, d’étranges réunions auxquelles personne ne vient, d’incompréhensibles rapports que nul ne lit, d’improbables programmes que personne n’assimile ; des spectacles tragiques, comiques, évanescents ; des icones comestibles, des jongleries budgétaires, des lois inapplicables ; des terrains dévastés, maquillés, pommadés ; des montagnes de déchets ensevelies sous du béton ; des mémoires supprimées, instrumentalisées, reformulées, commémorées ; des théories irréalistes que viennent suppléer des pratiques innommables à l’ombre d’une rhétorique policée, etc… Il suffit de faire un petit tour dans les hôpitaux, les écoles, les associations, les cabinets de « consultants », les galeries d’art, chaque recoin de la société, et de jeter un regard circulaire sur les contradictions bizarres ou malsaines qui s’y tapissent, en deçà des images et des discours officiels…

 politiques. Il identifia quatre mythes récurrents dans son ouvrage Mythes et Mythologies politiques : "la conspiration, le sauveur, l’âge d’or et l’unité". C’est ainsi qu’il distingua la répétition de certains processus d’héroïsation, de diabolisation, de nostalgie et de rejet en période de crise ou de bouleversements…
politiques. Il identifia quatre mythes récurrents dans son ouvrage Mythes et Mythologies politiques : "la conspiration, le sauveur, l’âge d’or et l’unité". C’est ainsi qu’il distingua la répétition de certains processus d’héroïsation, de diabolisation, de nostalgie et de rejet en période de crise ou de bouleversements… 
 s’imposant vit des enjeux de son vouloir. Il vit essentiellement en un risque de son essence, risqué à l’intérieur de la vibration de l’argent et du valoir des valeurs. En tant que perpétuel changeur et médiateur, l’homme est « le marchand ». Il pèse et évalue constamment, et pourtant ne connaît pas le poids des choses. Il ne sait pas non plus ce qui en lui a vraiment du poids »**.
s’imposant vit des enjeux de son vouloir. Il vit essentiellement en un risque de son essence, risqué à l’intérieur de la vibration de l’argent et du valoir des valeurs. En tant que perpétuel changeur et médiateur, l’homme est « le marchand ». Il pèse et évalue constamment, et pourtant ne connaît pas le poids des choses. Il ne sait pas non plus ce qui en lui a vraiment du poids »**.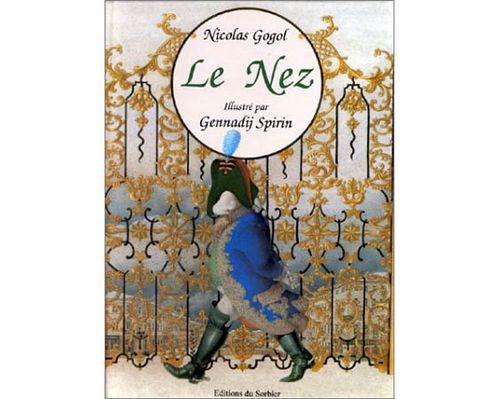

 Une attention qui se porte davantage sur l'essence d'une pensée que sur ses véhicules, quoique les véhicules ne soient jamais laissés de côté...
Une attention qui se porte davantage sur l'essence d'une pensée que sur ses véhicules, quoique les véhicules ne soient jamais laissés de côté... Un dessinateur qui fit des études de médecine... Je renonce à entrer dans les complexités d'une analyse qui tendrait à expliquer l'étonnante symbiose qu'il fit de cet art contemplatif et de cette science des organismes... Toujours est-il que sa personnalité explique a elle toute seule le gigentesque engouement qui existe aujourd'hui au Japon pour les bandes dessinées, toutes classes d'âges confondues. Certes, il n'est pas toujours aisé de percevoir la ligne directrice qui initia le phénomène au milieu d'une telle profusion de mangas (sans parler du redécoupage arbitraire de certaines oeuvres après exportation) mais quels qu'en soient les différents degrés, on y retrouve bien souvent l'effort d'un langage universel (d'où la désillusion programmée des fans qui ne connaissent le Japon qu'à travers les animes, et qui ne mesurent pas l'écrasante rigueur d'une société fondée le sacrifice).
Un dessinateur qui fit des études de médecine... Je renonce à entrer dans les complexités d'une analyse qui tendrait à expliquer l'étonnante symbiose qu'il fit de cet art contemplatif et de cette science des organismes... Toujours est-il que sa personnalité explique a elle toute seule le gigentesque engouement qui existe aujourd'hui au Japon pour les bandes dessinées, toutes classes d'âges confondues. Certes, il n'est pas toujours aisé de percevoir la ligne directrice qui initia le phénomène au milieu d'une telle profusion de mangas (sans parler du redécoupage arbitraire de certaines oeuvres après exportation) mais quels qu'en soient les différents degrés, on y retrouve bien souvent l'effort d'un langage universel (d'où la désillusion programmée des fans qui ne connaissent le Japon qu'à travers les animes, et qui ne mesurent pas l'écrasante rigueur d'une société fondée le sacrifice).

